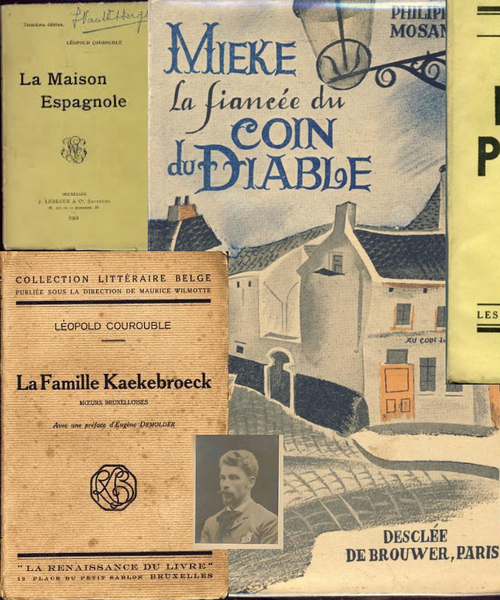La Bruxelles des écrivains, une histoire ambivalente

Une vision littéraire peu flatteuse
Du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, les descriptions et les représentations de Bruxelles se sont rarement avérées flatteuses. Longtemps refuge des intellectuels exilés, des écrivains désireux de fuir la censure, de ceux qui veulent abriter des amours scandaleuses, Bruxelles n’emporte pas l’adhésion de ses illustres visiteurs. En 1722, déjà, Voltaire raillait la capitale dans un poème adressé à M. de Formont :
« Pour la triste ville où je suis,
C’est le séjour de l’ignorance,
De la pesanteur, des ennuis,
De la stupide indifférence,
Un vieux pays d’obédience,
Privé d’esprit, rempli de foi. »
Et Baudelaire de lui répondre, dans le pamphlet qu’il méditait sur la Belgique : « Les trois derniers mots sont de trop » ; La Belgique déshabillée ne verra cependant pas le jour de son vivant. Les projets de démolition littéraire de la ville demeurent souvent dans la sphère privée ou, tout simplement, n’aboutissent pas. Pourtant le mal est fait : le texte de Baudelaire circulera et poussera, jusqu’à aujourd’hui, des cohortes d’écrivains à se positionner d’abord par rapport à sa Belgique déshabillée.
Du prestige intellectuel et libéral qui marquait la Bruxelles du XIXe siècle jusqu’à la position centrale qu’elle occupe dans l’imaginaire collectif contemporain, en tant que capitale de facto de l’Europe, l’imaginaire littéraire de la ville se fonde sur une mauvaise réputation que ne démentent qu’à peine les écrivains locaux : de vagues protestations molles, à peine une prise de position qui verse le plus souvent du côté de la concession. Les rares écrivains français qui ont assidûment fréquenté la capitale belge pendant le XIXe siècle ne laissent que quelques notes à la sauvette (Nerval, Hugo, etc.), à peine quelques poèmes de Verlaine, que l’on connaît nettement moins que le fameux coup de feu porté sur Rimbaud en plein Bruxelles. Même le héraut de la capitale, Odilon-Jean Périer, qui consacre à son « éloge » l’intégralité de son Citadin (1924), hésite entre « le gris éventail d’une ville éveillée » et la « menteuse logique » de son climat. Soit on s’abstient d’en parler, soit on en parle avec réserve.
Bruxelles, une ville mal aimée par les auteurs ?
Bruxelles ne dit que rarement son nom dans la fiction. Si Charlotte Brontë, qui avait vécu en pension dans la ville avec ses sœurs, a brossé un portrait provincial de la capitale belge dans Villette (1853), elle en tait le nom réel, qui n’apparaît que dans le roman posthume Le Professeur, sorte de version alternative de Villette. De nos jours, malgré l’affirmation géographique dans un nombre croissant de titres (Marcher au charbon de William Cliff en 1978, Place du Jeu de balle de Jean-Baptiste Baronian en 1980, Les Bonbons de Bruxelles de Nadine Monfils en 2001, Johnny Bruxelles de Philippe Blasband et Dans la cité Volta de Nicolas Ancion en 2005, Expo 58 de Jonathan Coe et L’Entrée du Christ à Bruxelles de Dimitri Verhulst en 2013), les écrivains continuent d’éprouver une réticence à se réclamer du toponyme : François Emmanuel consacre un roman entier à la ville sans en écrire une seule fois le nom (Le Sentiment du fleuve, 2001) ; Grégoire Polet tarde à nommer la ville dans Excusez les fautes du copiste (2006) alors que tous les lieux évoqués sont bruxellois ; quant à Jean-Philippe Toussaint, l’un des écrivains bruxellois les plus lus dans le monde, il n’évoque sa ville que depuis très récemment (Football en 2015 et Made in China en 2017).
Bruxelles, ville honteuse ? En littérature, la ville ne souffre pas la comparaison avec les autres capitales européennes. Marguerite Yourcenar indiquera dans ses Souvenirs pieux (1974) que Bruxelles possède « les agréments de la grande ville », ce qui sous-entend que la capitale n’est pas vraiment une grande ville, en dépit de son cosmopolitisme croissant, parce qu’elle se démarque par des aspects provinciaux que repéraient Brontë comme Baudelaire. Ainsi, comment prendre au sérieux « la petite capitale d’un pays minuscule […] sur le déclin, où l’on parle français avec des sabots de Campine et des alluvions de l’Escaut dans la voix » (Nicolas Ancion, Dans la cité Volta, 2005) ? Les représentations de la capitale évoluent entre myopie et anonymat : on ne décrit pas Bruxelles, on la juge plutôt.
Le caractère peu raffiné des habitants de la ville, qu’ont pointé de nombreux écrivains à la suite de Baudelaire relève de ce trait paradoxal typique des Bruxellois que décrivait Charles De Coster dans l’une de ses Légendes flamandes (1861) : « la simplicité et la ruse, la naïveté et la malice, l’intelligence et ce qui n’y ressemble pas ; Dieu et le diable, le bien et le mal, comme partout ». Chez les Bruxellois de papier, c’est la déprime qui domine. Les femmes finissent par s’y trouver laides parce qu’elles n’y sont pas importunées par les hommes (Mertens, Terre d’asile) et « [m]ême les pigeons finiss[e]nt par se suicider à Bruxelles » (Laurent de Graeve, Je suis un assassin, 2002).
Pourtant, de Camille Lemonnier (Un mâle, 1881) et Émile Verhaeren (« Les Chantres de la forêt de Soignes », 1914) à Dominique Rolin (c’est notable depuis La Maison la forêt en 1965 jusqu’à La Rénovation en 1998), la proximité de la forêt offre une splendeur dont Bruxelles pourrait se vanter. Mais Bruxelles semble, aux yeux de la majorité des écrivains du XIXe au XXIe siècle, engoncée dans une forme d’autodénigrement dont l’origine demeure obscure. La beauté de la capitale est, à l’instar de la maison Delune sur l’avenue Franklin Roosevelt chez Jacqueline Harpman, « comme isolée […] dans une enclave imaginaire, un peu hautaine, princesse exilée qui maintient autour d’elle le protocole exigé par son rang, fermée au monde, lourde de secrets » (Le Bonheur dans le crime, 1993).
L’envers du décor de Bruxelles
Il en va de même des symboles de la ville. Le joyau qu’est la Grand-Place paraît par conséquent toujours devoir se parer d’un revers moins glorieux, que ce soit chez Verhulst, qui n’y voit rien de moins qu’« une des plus belles places de toute la croûte terrestre. Sombre et morose, mais belle » (L’Entrée du Christ à Bruxelles), ou chez Mertens : « Les touristes, on ne les retrouvait qu’à la Grand-Place, comme si c’était décidément la seule chose à voir dans cette ville ou comme si, traqués jusque-là, ils se préparaient à subir dans cette enceinte un assaut en règle » (Terre d’asile).
Les écrivains belges comme étrangers s’en donnent à cœur joie, depuis Baudelaire, pour souligner l’aspect repoussant et inquiétant de la ville. Ainsi, Thomas Pynchon, dans son gigantesque Contre-jour (2006), souligne la présence d’un « foyer criminel aux abords de la gare du Midi », alors que Dimitri Verhulst, dans L’Entrée du Christ à Bruxelles (2011), explique que Bruxelles ne manque pas de pardonner les crimes les plus impardonnables : « Ici, à Bruxelles, on peut vider le chargeur d’un revolver sur un autobus en marche et en sortir avec un bracelet électronique et une session chez le psychologue. » Paradoxalement, les pires défauts prêtés à la capitale belge sont contrebalancés par d’autres défauts.
L’atmosphère semble en cause. Michel Houellebecq, dans Soumission (2015), associe saleté, tristesse et haine : « c’étaient surtout la saleté et la tristesse de la ville qui m’avaient frappé, ainsi que la haine palpable […] ; à Bruxelles on se sentait, plus que dans toute autre capitale européenne, au bord de la guerre civile ». La menace plane sur la ville, à commencer par celle de son propre délabrement : « on ne peut plus parler de ruine, non, une ruine c’est autre chose – une injure à la mémoire, la trace du temps qui enjambe les siècles », écrit Baronian (Place du Jeu de balle).
La belgitude : entre iconoclastie et nostalgie
Selon Ghelderode, c’est « l’atavique iconoclastie du Belge » (Mes Statues, posthume) qui a conduit à cette refonte perpétuelle du paysage de la ville, le plus souvent dans le sens de l’enlaidissement. La nostalgie des souvenirs d’un passé révolu, c’est bien ce qui obsède la plupart des écrivains belges, de Neel Doff qui se plaint de la disparition des magasins de la rue Montagne-de-la-Cour (Keetje, 1919) jusqu’aux regrets exprimés dans La Grande Roue de Jacques De Decker (1980), au sujet de la Bibliothèque royale, « parce qu’elle avait été édifiée là où, jadis, déferlaient les jardins en escalier du Mont-des-Arts », en passant par William Cliff, qui conclut poétiquement : « voilà Bruxelles dix siècles d’accouplements de proliférations et de cortèges d’hommes bouffis d’importance inutile comme ces tours ces cathédrales et ces nuages qui s’en vont dans le jour » (Marcher au charbon).
Le même poète ouvre cependant l’horizon de Bruxelles sur l’imaginaire et l’invention : « Où est la Maison du Peuple avec ses nouilles de fer forgé tressées par Horta, […] qu’en avez-vous fait ? Oh, je vois : vous l’avez abattue pour construire un building parallélépipède et de béton armé ! Quelle imagination ! » (Écrasez-le, 1976). Le renversement subversif qui donne au vulgaire, au quelconque ou au morose ses lettres de noblesse fait ainsi partie intégrante de l’imaginaire de Bruxelles que construisent les écrivains. En ce sens, la remarque de Dimitri Verhulst sur le Manneken Pis s’avère aussi percutante que son évocation par Eekhoud (Voyous de velours) ou Ghelderode (Mes Statues) : « Longtemps ça m’a troublé que notre symbole national fût un pisseur tout nu, comme si nous cachions notre manque d’ambition derrière de l’humour facile, scatologique » (L’Entrée du Christ à Bruxelles).
La ville sent mauvais de toutes parts, comme chez Stefan Hertmans à chaque fois qu’il l’évoque dans Comme au premier jour (2001). Odeurs d’égout ? C’est déjà l’opinion de Georges Eekhoud dans Voyous de velours (1898). La ville est traversée d’une rivière – la Senne – qui fut enterrée pour des raisons d’hygiène, permettant à Baudelaire et à Cliff de dialoguer à un siècle d’intervalle : « Le Faro est tiré de la grande latrine, la Senne ; c’est une boisson extraite des excréments de la ville » (La Belgique déshabillée) ; « la Senne roule un excrément dans la lumière atroce d’un jour mourant où Baudelaire ricane et puis s’endort » (Écrasez-le). Le voûtement de la Senne donne d’ailleurs lieu à plusieurs fantaisies qui frisent avec le fantastique, comme dans l’album Brüsel des Cités obscures de François Schuiten et Benoît Peeters ou encore dans Le Sentiment du fleuve de François Emmanuel (2003), qui ressasse le « mythe que la ville s’était forgé pour racheter son habitude d’amnésie ». Car à l’autodénigrement répond une autodérision qui remet, plus que dans n’importe quelle autre capitale de fiction, l’imagination au centre. Bruxelles ne sera pas décrite, elle sera inventée.
Une ville surréaliste
Les épisodes bruxellois sont souvent, dans les romans contemporains, baignés dans une atmosphère délicieusement – et presque orgueilleusement – surréaliste. De manière paradoxale, Pierre Mertens et Nicolas Ancion s’accordent sur les distances trompeuses de la capitale : « ici rien n’est loin de rien », affirme le premier dans Les Éblouissements (1987), quand le second semble lui rétorquer avec malice que « rien n’est jamais juste à côté, tout est toujours juste trop loin » (Dans la cité Volta). Mertens va plus loin dans l’analyse du phénomène en faisant de Bruxelles une ville qui, irrémédiablement, échappe à qui cherche à la saisir : « Oui, il pense, cet occupant, ce conquérant, qu’il s’est approprié la ville. Quand c’est le contraire qui s’est passé : il en a perdu jusqu’au sens. Et il s’en vide encore un peu plus à chaque heure de ses pérégrinations. » (Les Éblouissements).
Le « sentiment d’étrangeté » ne cesse de saisir les personnages qui osent se balader dans la capitale, parce que celle-ci regorge de lieux improbables aux noms non moins improbables (« la rue de l’Hectolitre, je me demande où ils vont chercher les noms de ces petites rues du centre », s’interroge la narratrice du Beau-fils d’Ariane Le Fort en 2003), autant que de situations surréalistes, comme celle d’avoir d’énormes colonies de perruches sillonnant son ciel, et qui donnent l’impulsion du roman d’Éric-Emmanuel Schmitt, Les Perroquets de la place d’Arezzo (2013).
La topographie et le climat particulier de la ville la nimbent souvent dans une impression d’irréalité ou de rêve. W. H. Auden le laissait entendre, à la fin des années 1930, dans son « Brussels in Winter » : « Its formula escapes you; it has lost / The certainty that constitutes a thing. » L’impression d’« entrer dans le tableau » L’Empire des lumières de Magritte (La Méthode Arbogast) coïncide avec les jeux de lumière qui imprègnent toute tentative de décrire l’ambiance de la ville, de l’illusion d’optique que relève déjà Verlaine dans l’une des « Simples fresques » qu’il consacre à Bruxelles :
« La fuite est verdâtre et rose
Des collines et des rampes
Dans un demi-jour de lampes
Qui vient brouiller toute chose. » (Romances sans paroles, 1874)
jusqu’à assemblage incongru de munificence et d’indigence, ainsi que s’y emploie Périer à travers « Les Saisons de Bruxelles » :
« Flamme, église de fer, tombeau, bois de la Cambre !
Toutes les îles d’or que tu fis en novembre
S’effondrent d’un seul coup par le glaive rouillé
Que brandissent les dieux sur ton front dépouillé. » (Poèmes, 1928)
Indéfinissable, indescriptible, presque irréelle, Bruxelles l’est assurément. Bordée d’une splendide forêt, creusée en son centre de l’écrin de la Grand-Place, celant en son sein une rivière putride, dévoilant des attraits immédiatement gâchés par quelque détail incongru ou vulgaire, la capitale belge inspire aujourd’hui plus que jamais les écrivains d’ici et d’ailleurs, parce qu’elle refuse obstinément de se laisser saisir tout en accueillant à bras ouverts le plus grand nombre. Pour le dire avec Cliff, dans son poème intitulé « Ma grand-ville » :
« c’est la ville
la plus la plus la plus
du monde
[…]
bas les pattes !
touchez pas à nos laideurs ! » (Marcher au charbon)
Christophe Meurée est premier assistant scientifique aux Archives et Musée de la Littérature.