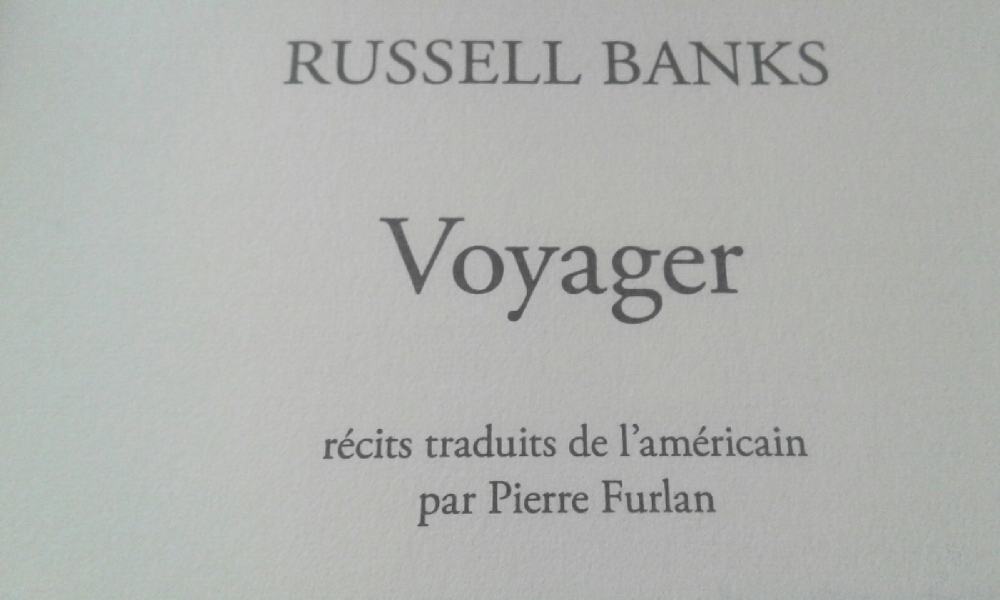Russell Banks par son traducteur français

Le traducteur et auteur français Pierre Furlan nous dévoile la longue histoire professionnelle et amicale qui le lie depuis près de trente ans à l’écrivain américain au parcours insolite.
Traduire, écrire
Pierre Furlan, qui a passé ses années d’études à l’université de Berkeley en Californie, traduit des auteurs anglophones renommés, depuis les Américains Russell Banks, Paul Auster, Denis Johnson ou Hector Tobar, jusqu’aux Néo-Zélandais Alan Duff, Elizabeth Knox et John Mulgan.
Par ailleurs, Pierre Furlan est l’auteur de romans, de nouvelles et d’essais littéraires. Son intérêt pour le peintre suisse Louis Soutter est à l’origine de son roman La Tentation américaine (Actes Sud, 1993) et du récit publié chez Esperluète, Le Violon de Soutter (2003). Les nouvelles de L’Atelier de Barbe-Bleue (Actes Sud, 2002), Paekakariki (Esperluète, 2011), puis récemment Ma route coupait droit à travers le monde (Esperluète, 2018) montrent son souci permanent d’une forme courte et incisive qui tranche avec l’inertie du monde.
Traduire Russell Banks
« Je traduis Russell Banks depuis presque trente ans. Trois décennies pendant lesquelles sa réputation n’a fait que croître et le place aujourd’hui parmi les plus grands écrivains américains de notre époque. Je suis évidemment heureux d’avoir contribué à le faire connaître dans la sphère francophone. La première fois que j’ai entendu parler de lui, c’était par un autre écrivain américain, Paul Auster, en 1987, un soir où nous dînions dans un restaurant thaï de Brooklyn.
Le lendemain, je devais rentrer à Paris, et le roman de Banks que j’ai déniché à l’aéroport n’était autre que Continental Drift (Continents à la dérive) qui venait de connaître un grand succès aux États-Unis. Je l’ai en partie dévoré dans l’avion. Banks y attaquait de front le rêve américain, et il le faisait en prenant le parti des petites gens, de ces Américains moyens de Nouvelle-Angleterre qui étaient non seulement les oubliés du rêve mais devaient une grande partie de leurs malheurs au fait d’y avoir cru. C’était un roman haletant, très bien mené, que j’ai tout de suite eu envie de traduire. Et puis j’ai découvert qu’il était déjà paru en France sous le nom de Terminus Floride et qu’il s’était très mal vendu. Par bonheur, Hubert Nyssen, fondateur des éditions Actes Sud, a décidé d’éditer malgré tout cet auteur encore peu connu, et c’est ainsi qu’en 1990 j’ai commencé à traduire Le Livre de la Jamaïque. J’ai donné ensuite la version française de quatorze ouvrages de Banks et notre compagnonnage de trente ans s’est mué depuis longtemps en amitié.
Russell Banks jette un regard aigu non seulement sur les injustices de son pays mais aussi sur la manière dont elles sont occultées et, de fait, propagées par la mythologie ambiante. On pourrait se demander pourquoi un auteur dont la vie ressemble à une success story et qui en a même donné quelques aperçus sous ce titre (Histoire de réussir, 1994) s’en prend à un mythe dont, après tout, il est une bonne illustration et, d’un certain côté, le bénéficiaire. En effet, il appartient à une famille ouvrière dont le père, violent et alcoolique, est parti en laissant une femme et quatre enfants pratiquement sans ressources. Alors âgé de douze ans, Russell a dû assumer une situation familiale difficilement supportable. Il a fini par fuguer : à seize ans, tout juste muni de son permis de conduire, il aide un de ses amis à voler la voiture neuve du père de cet ami, et les deux ados traversent ainsi les États-Unis en rêvant de fuir jusque dans les mers du Sud. Mais la police les rattrape en Californie et Russell, rentré au Massachusetts, décide de se mettre au travail scolaire. Il y réussit, obtenant une bourse qui lui permet d’intégrer une université privée. Las, trois mois à peine dans cet univers de riches étudiants, le jeune Russell fugue de nouveau et part en stop vers la Floride avec l’idée de rejoindre Fidel Castro à Cuba. Il s’arrêtera à Miami et deviendra un temps apprenti étalagiste avant de se marier, à dix-neuf ans, avec la fille, tout juste sortie du lycée, qui sert de modèle pour présenter les maillots de bain. Père à vingt ans, il divorce à vingt-et-un et se mariera encore trois fois. Il mentionne tout cela dans son dernier livre, Voyager (2017), et ce ne serait sans doute qu’anecdotique si ces étapes – ratages et reprises – ne se lisaient comme l’autre face d’un devenir écrivain qui a magistralement réussi. Or, Russell Banks ne veut pas faire de son cas une généralité. Non, car le plus grand écueil psychologique, pour les petites gens, c’est de croire que tout leur est ouvert, que chacun peut réussir et devenir milliardaire au prétexte que, dans leur beau pays, les chances sont égales pour tous. Et le corollaire encore plus insidieux de cette croyance, c’est d’estimer que la pauvreté serait due au vice et qu’il n’y aurait donc pas lieu d’aider les pauvres ou ceux qui échouent : ils méritent leur punition comme les autres méritent leur tas d’or. Ainsi, dans plusieurs de ses livres, Banks représente des Américains moyens qui découvrent à leurs dépens que la réalité ne fonctionne pas comme ils ont bien voulu le croire et qui se sentent alors dupés par une sorte de publicité mensongère. Et la perte de cette illusion s’accompagne en général de leur autodestruction. Dans Amérique, notre histoire (2006), Banks est on ne peut plus explicite à ce sujet : « L’Américain authentique, écrit-il, est quelqu’un de cynique, de matérialiste et d’avide (il cherche de l’or) et qui, pourtant, se sent une mission idéaliste, voire religieuse. Quand on se raconte un mensonge aussi gros et qu’on l’appelle rêve, on finit par commettre des actes violents. C’est dans la psychologie humaine. Et si cela entre dans la mythologie de notre peuple, alors nous sommes obligés d’agir violemment en tant que peuple. »
Mais cette vision, aussi juste soit-elle, ne suffit pas à faire un écrivain. Elle n’aurait même pas grande valeur si elle n’était pas incarnée de façon vivante, parfois irréfutable, par les vies que Banks met en scène. Elle n’est pas plaquée sur la réalité, mais la révèle. Toute écriture authentique est en effet un déchiffrage. Dans ses grands romans comme dans ses nouvelles, Banks ne place jamais le concept, ou l’idée, avant l’observation sensible. S’il a un point de vue avant d’écrire, le travail d’écriture, c’est-à-dire la nécessité de faire vivre le monde qu’il décrit, se chargera de le relativiser. Ses personnages sont complexes, surprenants comme le sont dans la vie les personnes que nous aimons. Ce respect pour la vérité des personnages est, au fond, le premier respect qu’un écrivain doit à ses lecteurs et, en retour, il donne à l’écrivain sa densité, lui ouvre le monde et lui permet de se renouveler. J’y vois un aspect essentiel du talent. Et si ses personnages sont aussi complexes et faillibles, c’est entre autres parce qu’il n’existe pas de self made man, que nous vivons dans une interdépendance dont l’auteur est lui aussi tributaire. C’est une des vérités vivantes que trente ans de travail sur les œuvres de Russell Banks m’ont enseignées, et je l’en remercie. »
Retrouvez Russell Banks durant le festival :