Le Bruxelles littéraire des echte Brusseleirs

Amélie Peperkoor, Mieke du Coin du Diable, Joseph et Adolphine Kaekebroeck et les autres : une promenade dans la « littérature des mœurs bruxelloises ».
Madame Amélie Peperkoor habite Molenbeek. Frédéric Van der Elst le dit dans le roman qui porte le nom de la dame et qui est paru en 1930. Mais où à Molenbeek ? L’écrivain précise simplement : dans un quartier neuf de Molenbeek. Mais comme la Veuve Peperkoor tient un commerce de peausserie, qui nécessite de l’entreposage d’un côté et un comptoir de vente de l’autre, on peut supposer que feu son mari avait installé son magasin pas trop loin du canal ni de la chaussée de Gand et qu’il avait réservé les étages pour loger la famille. Qui se résume à Amélie et à sa fille Eudoxie.
Des comédies souvent, des drames quelquefois
Loin des aigreurs de Baudelaire sur Bruxelles, loin des saillies ironiques d’Octave Mirbeau sur la ville et ses habitants, loin de cette littérature acariâtre qui vomit notre belle capitale, loin du coup de feu entre Verlaine et Rimbaud et de l’installation de Victor Hugo Grand-Place ou place des Barricades, j’ai voulu me promener dans la littérature de mœurs bruxelloises, ces comédies souvent, ces drames quelquefois, qui ont engendré des succès comme Le mariage de Mlle Beulemans ou Bossemans et Coppenolle.
En partant de Molenbeek, où j’habite, pour descendre la chaussée de Gand, gagner le coin du Diable, proche de la rue Dansaert, puis la rue des Chartreux et enfin boire un café au Greenwich, antique bistrot à la parisienne, même s’il porte un nom anglais, construit en 1914 en style Art Nouveau. Balade agréable et vivifiante en ce dimanche automnal de fin octobre.
Ni portrait ni bio sur internet
Frédéric Van der Elst n’a pas laissé de marque indélébile dans l’histoire littéraire belge. Son nom y est cité, certes, mais sans plus. Ni portrait ni bio sur internet. Tant pis, c’est sa Madame Peperkoor qui parlera pour lui. Et, chance, elle parle d’or. Avec un fort accent et dans le patois bruxellois, populaire certes, mais si pittoresque et joyeux. L’éditeur de ce Madame Peperkoor a un pied à Paris, où il voulait aussi vendre ce roman couleur locale bruxelloise : il a donc placé des sous-titres à chaque saillie en bruxellois, sous forme de notes. Ce qui est un peu fastidieux pour un Bruxellois bon teint. Mais qui est moins superflu pour d’autres, sans doute.
Mme Peperkoor et sa fille sont des bourgeois. Pas des millionnaires, mais assez fortunées pour acquérir un château du côté de Dinant et une automobile pour s’y rendre. Et pour ne pas se priver. On peut les suivre dans leurs pérégrinations. En auto jusqu’en Ardennes. Mais aussi en tram à Bruxelles et à pied dans le quartier.
Accompagnées d’amies, Eudoxie va prendre le five o’clock au Pavillon bleu, avenue Louise. A d’autres moments, on la suit chez Fine, rue Sainte-Catherine, pour voir une druppelke. Un établissement installé au premier étage d’un magasin de verdure et d’épicerie. Pas de description de la façade, mais ça pourrait être la maison qui accueille aujourd’hui l’Amedeo, ou le Bar des Amis ou le Monk. En tout cas, des fenêtres, la famille Peperkoor et leurs amies applaudissent la fanfare qui inaugure la braderie. La première braderie belge fut ouverte rue Sainte-Catherine en 1922.
Le coin du Diable, la fête de Satan
De Molenbeek, il suffit de passer le pont du canal. On emprunte la rue Antoine Dansaert, on tourne à droite dans la rue d’Alost, on bute sur la rue de la Serrure, on prend à droite et c’est la rue Vandenbranden, qui sinue entre de vieilles maisons, des entrepôts rénovés et de nouvelles constructions jusqu’à la rue Notre-Dame du Sommeil. C’était jadis un coin désolé, un îlot de pauvreté, peuplés de braves gens et de voyous, où s’ouvrait une impasse du Coin du Diable. On y construit beaucoup aujourd’hui, comme pour faire oublier la mauvaise réputation d’antan.
D’après Mieke, la fiancée du Coin du Diable, le roman de Philippe Mosane sorti en 1938, on y fêtait Satan chaque 16 août. On portait sur les épaules de quatre hommes la statue du diable, qui logeait le reste de l’année dans un mur. « Après la fête, raconte Mieke, on se battait souvent et il arrivait encore bien que deux hommes s’emparent d’un autre pour le jeter au canal. »
« Monsieur l’Abbée »
Un écrivain pourtant bon chrétien que ce Philippe Mosane, qui installe son histoire édifiante dans ce coin-là. Mosane, un autre nom qui ne dit pas grand-chose, sinon qu’il a publié un autre roman en 1941, Belle Jeunesse. Il écrivait de la littérature militante, à la suite de Maxence Vandermeersch, en faveur du mouvement ouvrier chrétien.
Mieke est une dévote femme de 25 ans qui est éperdument amoureuse de Nel, 26 ans. Mais Mieke est malade. Elle a déjà été implorer la Vierge de Lourdes. Grâce à Dieu, et ce n’est pas une formule, elle mourra dans la dignité de la dévotion et de l’absolution. Grâce à un prêtre ouvrier aussi, qui s’occupe d’elle – enfin de son âme – et qu’elle appelle tout au long du roman « Monsieur l’Abbée », avec ce « e » long qu’on dit dans les quartiers populaires de Bruxelles.
Une âme simple, Mieke. Mais pas une grande héroïne de roman, non. Le seul intérêt du livre de Mosane, c’est le Coin du Diable, qui n’a pas connu d’autre couverture romanesque, je crois. Et sa couverture, un beau dessin qui court sur le recto et le verso et qui montre ce quartier de Bruxelles. Si paisible là qu’il semble baigné de la bonté divine…
L’aimable paradoxe de Léopold Courouble
Avec Léopold Courouble, on vise tout autre chose. Lui, c’est un écrivain, un vrai. Il fut célèbre de son vivant. Il a inventé « le roman bruxellois » avec La famille Kaekebroeck. Les milieux littéraires belges ne le boudaient pas, au contraire : il fut membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Il était né en 1861, il mourut en 1937. En fait, comme ses parents, des bourgeois aisés, l’avaient envoyé faire ses études en France de ses 8 à ses 16 ans, il parlait un français très châtié, lui qui fit du parler bruxellois un des aspects pittoresques et attachants de ses romans de mœurs bruxelloises, comme il les sous-titrait. Aimable paradoxe.
Il avait fait son droit à l’ULB. Mais le droit l’ennuyait. Il fit le journaliste puis l’écrivain. En 1901, il publia son premier roman « régional » : La famille Kaekebroeck. Il en écrivit quatre autres de cette série : Pauline Platbrood, Les Noces d'or de monsieur et madame Van Poppel, Les cadets du Brabant et Madame Kaekebroek à Paris. Ces livres eurent un succès fou : on réédita quinze fois le premier jusqu’en 1940.
Pour rejoindre Léopold Courouble et la famille Kaekebroeck, il suffit de tourner le coin, ou presque. On prend la rue Notre-Dame du Sommeil jusqu’à la place du Jardin aux Fleurs (quels jolis toponymes !) et voilà la rue des Chartreux. Qui menait jadis en effet au couvent des Chartreux qui s’y était installé, du côté de la rue des Fabriques. Et qu’on prend dans l’autre sens, vers la Bourse. A droite, au numéro 38 actuel, s’érige une large et haute maison de style espagnol, avec pignons à degrés. C’est à peu près la même qu’en 1861, quand Léopold y poussa ses premiers cris.
Car c’est là qu’il est né, le futur écrivain, et qu’il passa son enfance. Il allait à l’école rue du Boulet, à deux pas. Et il rêvassait dans le grand jardin qui prolongeait la belle maison et qui fut amputé, lors des travaux du voûtement de la Senne, voulu par le bourgmestre Anspach et inauguré en 1870, d’une grande partie, celle qui rejoignait un bras de la rivière qui arrosait, alors, Bruxelles.
Courouble a parlé de ce lieu de son enfance dans La Maison espagnole (1904). En voici le début.
« Rue des Chartreux, une façade en briques rouges surmontée d'un double pignon à redans. Porte cochère, massive jadis, flanquée de bornes écorchées par la roue des chars et polies par les ketjes riders. Entrons. Large vestibule à trottoirs ; antichambre surélevée de quelques marches, dallée en pierres noires et blanches. Au rez-de-chaussée, trois vastes salles lambrissées à hauteur d'appui et une office ; aux étages, des chambres spacieuses, des mansardes et des greniers énormes. Abrégeons cette affiche de notaire.
Donc, une maison « cossue », l'archétype des maisons bourgeoises de la ville basse, un hôtel du passé entretenu avec révérence, propre et net du haut en bas à force de balais, de seringues, de loques à « reloqueter » !
C'était la demeure de mon aïeul maternel. Elle échut à mes parents ; c'est là que s'écoulèrent mon enfance et ma jeunesse. La fortune changeante nous l'a enlevée; mais je la revois souvent en rêve : car, bien qu'elle existe toujours, elle a subi d'importantes restaurations qui ont un peu adultéré son architecture de jadis. Le plan Anspach recula d'abord la façade, que l'on rajeunit par des bossages de pierre blanche et en laissant à vif la chair rose de ses briques ; puis, dommage plus cruel, les démolisseurs rasèrent son vieux jardin, l'un des plus beaux du vieux Bruxelles. Ce jardin me tient surtout au coeur : mes souvenirs m'y ramènent sans cesse (…)
Mais ce qui faisait de notre jardin un séjour de perpétuel enchantement pour moi, c'est qu'il était margé, sur une longueur de près de cinquante mètres, par la Senne qui coulait en profond contre bas. De ce côté, un mur très peu élevé laissait apercevoir les maisons de l'autre rive, tout un noir fouillis, une eau-forte de bicoques en bois dressées sur d'innombrables pilots, pourries, sordides, se bousculant hors de l'aplomb et dont les petites fenêtres aux vitres crevées et crasseuses se pavoisaient en toutes saisons de guenilles magnifiques. Un terrible tapage de bâtons écurant le ventre des tonneaux s'échappait de ces masures lacustres où de volumineux brasseurs vêtus d'un pilou encroûté et confit, besognaient sans relâche, triturant, mélangeant, clarifiant les glorieuses bières bruxelloises. »
Une gueuze ou une crise
La maison admirée, le souvenir des Kaekebroeck, Platbrood, Keuterings, Van Poppel et Cappellemans, les héros de Courouble, évoqué, on peut faire un (petit) détour par l’hôtel de ville, où l’on peut admirer les peintures de Jean-Baptiste Van Moer montrant ce bras de Senne depuis la rue des Teinturiers ou le pont de la Carpe. Puis se poser quelques minutes et se désaltérer d’une gueuze ou d’une kriek un peu plus loin, au Marché aux Herbes, à l’Imaige Notre-Dame par exemple. Où l’on pourra lire l’adresse aux lecteurs de Léopold Courouble à la fin de Pauline Platbrood :
« La famille Kaekebroeck, c’est l’histoire d’un coin de notre Ville chérie, une histoire en petites images crûment colorées comme celles d’Epinal. Regardons-les avec indulgence. Peut-être témoigneront-elles un jour du passé ingénu, quand Bruxelles, impitoyablement saccagé au profit de la banalité moderne, perdra le souvenir de ses jolies ruelles et ne saura plus même la place de son berceau. » Cela a été écrit en 1902…
Et c’est le lieu et le moment, de lancer, comme on dit chez Courouble : « Maintenant, savez-vous, on va une fois prendre un bon verre. »
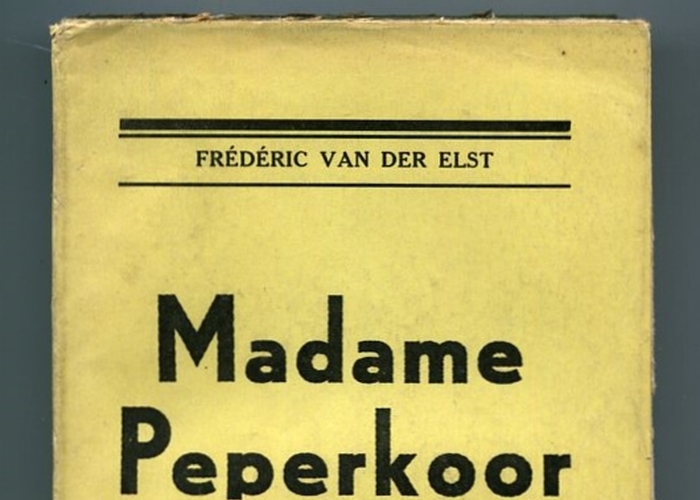



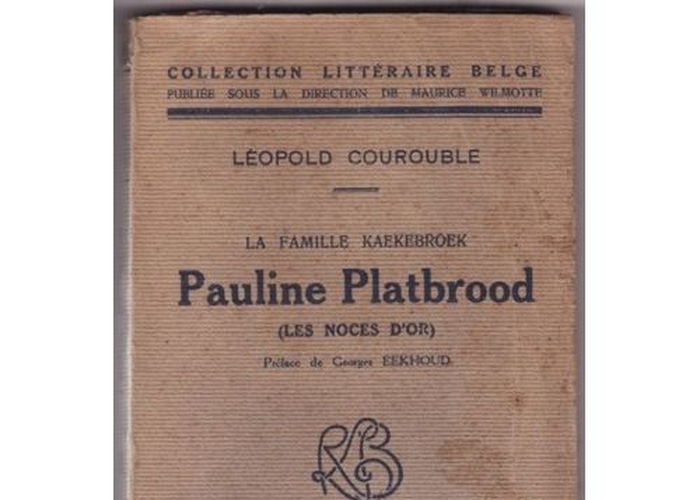
 Léopold COurouble
Léopold COurouble
